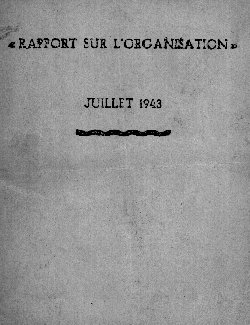
| retour accueil | retour chronologie | retour
chronologie 1943 |
|
(Juillet 1943)
|
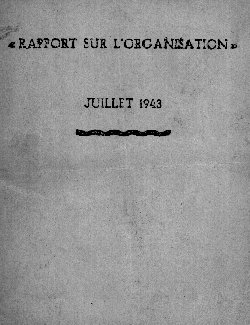 |
| PRESENTATION Le Rapport sur l'Organisation présenté ci-dessous fut rédigé par Barta en juillet 1943. Le Groupe communiste (qui deviendra l'Union communiste en octobre 1944) ne compte alors que quelques militants, très jeunes pour la plupart. Survenue à l’occasion d’un incident mineur mais révélateur de son irritation devant le manque de rigueur organisationnelle (le « mal français » dont se plaignait Trotsky !) , la séparation de Barta d'avec les trotskystes "officiels" remonte à septembre 1939. Mais la première véritable divergence politique apparaît à l'automne 1940 quand Barta découvre les concessions au nationalisme de militants issus du POI et du PCI. Il rédige alors (novembre 1940) La Lutte contre la deuxième Guerre mondiale impérialiste, seul manifeste authentiquement internationaliste en France à l'époque. Ajoutons que, produit de son sens politique et de sa fidélité aux analyses de Trotsky, il y prédit le retournement de Hitler contre Staline et la défaite de l'Allemagne. Au moment de la rédaction de la Brochure de 40, le groupe n'a que quatre membres : Barta, Louise (Irène), Jacques Ramboz (Lucien), ancien des Jeunesses communistes, et Fanny (Lucienne). Début 1941 Jacques Ramboz gagne son ancien condisciple du lycée Michelet, Mathieu Bucholtz (Pamp). Le "talent d'organisateur et [l'] imagination inventive" de Pamp en font rapidement la cheville ouvrière du groupe qu'il pourvoit de faux papiers, de machines à écrire et à dupliquer, etc. Il amène, de plus, quelques renforts : celui de son frère cadet, Michel, et celui de Pierre et de Jean Bois, ex-JC eux aussi. L'attaque allemande contre l'URSS marque un tournant dans la guerre. Le PCF abandonne le langage pseudo-internationaliste qui avait été le sien et renoue avec son chauvinisme outrancier. Dans ce contexte, le relatif développement du groupe permet d'entreprendre, en octobre 1942, la publication de la Lutte de Classes qui sera, jusqu'en avril 1947, l'organe du Groupe communiste puis de l'Union communiste. Le Rapport sur l'Organisation de juillet 1943 est, dans une certaine mesure, un texte d'éducation qui s'inscrit dans le processus de formation et de développement du Groupe communiste. Adressé à de jeunes militants, il accorde une large place à la clandestinité, vitale dans les circonstances de 1943. L'organisation et les méthodes que Barta juge nécessaire de faire prévaloir sont bien entendu celles du Parti bolchevik, du centralisme démocratique. "Centralisme rigoureux" dit-il, "qui prend tout son sens dans le contrôle politique souverain du parti ». Mais aussi, insiste-t-il, citant Lénine, "plus que la "démocratie : une confiance fraternelle entre révolutionnaires". Discipline donc, produit de la compréhension par chacun des buts et des moyens, mais aussi démocratie. Barta s'attache à en définir le contenu vivant : "Chaque responsable doit être convaincu organiquement que sans la démocratie, c'est-à-dire sans la participation active de tous, non seulement au travail pratique mais également à l'élaboration de la politique de l'organisation, il ne peut y avoir de parti révolutionnaire, donc de victoire du prolétariat sur la bourgeoisie" . La conception n'est certes pas neuve. Elle est celle formulée par Lénine dans Que Faire ?, mise en pratique des années durant par le Parti bolchevik dont Barta rappelle qu'il fut "un des partis les plus démocratiques qu'ait connu l'histoire" , celle de Trotsky aussi dont on est surpris, au travers des Oeuvres ou de la biographie de Pierre Broué de découvrir un dirigeant, bien sûr intransigeant sur les principes, mais aussi discutant patiemment, prenant en compte les arguments qui lui sont opposés, nuançant son point de vue, évoluant, revenant sur les questions, expliquant etc... Bref, un personnage à cent lieues du "prophète" péremptoire et cassant parfois peint en Trotsky et que, certains se sont ultérieurement plu à singer jusqu’à la caricature. Barta présente enfin une sorte de condensé de sa morale militante, montrant ce que l'activité authentiquement révolutionnaire, celle "conforme aux intérêts véritables de l'humanité" dégage "de dignité et, si l'on veut, de félicité" . Ces conceptions organisationnelles et morales furent celles qui guidèrent la formation des militants. Les succès relatifs remportés par l'UC témoignent de leur valeur. Il serait pourtant erroné de les attribuer aux seules formes organisationnelles prônées par Barta et de faire de la "méthodologie organisationnelle" la pierre philosophale de la politique révolutionnaire. L'efficacité de l'intervention de l'UC fut, avant tout, le produit d'une analyse des situations et de la mise en oeuvre d’une politique tout entière tendue vers un but. Dans l'optique de Barta, rigueur organisationnelle et politique révolutionnaire sont indissolublement liées. Le Parti bolchevik de Lénine l'avait illustré. Barta le répète ici, à son échelle et dans les conditions de la France de 1943. Vidé de sa substance révolutionnaire et ramené à une collection de recettes organisationnelles, le pseudo-centralisme démocratique conduit aux caricatures tragiques ou comiques, hélas courantes dans l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, texte de circonstance, le "Rapport 43" l'est sans doute. Mais il va bien au-delà. Par la forte impression produite sur ceux qui ont eu l'occasion de le lire alors et par la suite. Mais aussi parce que, d'une certaine façon, il est, encore aujourd'hui, d'actualité. A l'heure où il est de bon ton d'enterrer le bolchevisme avec l'URSS et les atrocités staliniennes, il témoigne de la hauteur morale des révolutionnaires de cette génération, renvoyant à leur ignorance intéressée ceux qui se complaisent à amalgamer le bolchevisme et ses sinistres parodies. Impossible, pourtant, de ne rien dire du sort de ce document, (« le petit machin de 1943 », disait Barta) après la disparition de l’UC en 1950. Récupéré, comme l’ensemble de l’héritage de l’UC et de Barta par Voix ouvrière puis Lutte ouvrière, il fut érigé en relique mythique. Réédité sans référence à son auteur et aux circonstances de sa rédaction (« C’est ce que « les copains » ont écrit en 43 »), il était remis aux responsables de l’organisation avec des mines de conspirateur pour être enfoui dans des tiroirs d’où il ne sortait que pour être furtivement exhibé au yeux de plus jeunes camarades, caution « historique » aux pratiques de LO… qui n’ont pourtant rien à voir avec celles décrites dans le Rapport 43. Avec la brochure « La Lutte contre la seconde guerre impérialiste mondiale » de 1940 (elle aussi « écrite par les « copains » et longtemps rééditée sans le nom de son auteur), le Rapport 43 a, des décennies durant, constitué l’un des principaux éléments de la captation d’héritage de l’UC par LO. Le paradoxe est que, même depuis sa première réédition en avril 1992 par le Centre Pietro Tresso (Florence, Italie), la fable de la filiation entre Lutte ouvrière et l’UC a trouvé à se nourrir de ce texte désormais public. Faisant complètement abstraction des conditions de sa rédaction rappelées ci-dessus et de ce qu’était l’UC en 1943, ignorant aussi le plus souvent ce que sont les pratiques internes de LO, certains ont cru déceler dans le Rapport sur l’organisation les prémices de ce qu’est Lutte ouvrière. Ce n’est pas plus sérieux que d’essayer de faire porter au Que Faire ? de Lénine la responsabilité des crimes de Staline ! Il est arrivé souvent dans l’histoire que ceux que Trotsky nommait avec mépris les épigones tentent de parer leurs agissements de la caution de noms plus grands que les leurs en dévoyant leurs textes et leur pensée : Napoléon-Bonaparte et Napoléon 1er, Staline et Lénine, etc. Il est regrettable qu’une partie de ceux qui souhaitent, parfois sincèrement, participer à l’écriture de l’histoire telle qu’elle fut et non pas telle qu’il est admis qu’elle ait été tombent dans le panneau. Richard Moyon |
|
David
Korner [BARTA]
La composition
petite-bourgeoise des groupements de la IVe Internationale en France a
été prouvée par l'attitude qu'ils ont prise
après
Juin 1940 devant l'occupation impérialiste du pays. La grande
majorité
de ces éléments groupés dans les "Comités
français
de la IVe Internationale"(*)
(actuellement POI) ont alors abandonné la position
internationaliste
en faveur d'un "front commun avec tous les éléments
pensant
français". D'autre part certains membres en vue sont
passés
à des positions nettement fascistes. Ainsi se justifie
définitivement
la rupture avec tous ces éléments, rupture que nous avons
accomplie en octobre 1939 pour nous délimiter d'un milieu petit
bourgeois, dont les pratiques organisationnelles étaient
social-démocratiques
et non communistes.
Cette situation désastreuse du mouvement de la IVe en France s'explique de la manière suivante : Les idées de l'Opposition russe, qui furent la base de la naissance du courant de la IVe Internationale, n'ont pas pu pénétrer dans un milieu ouvrier en France. Le prolétariat se trouvait dans ce pays sous l'emprise de deux partis prolétariens opportunistes, dont l'un, le PC, se parait du prestige de la révolution d'Octobre. Le fait que ces idées ont été adoptées surtout par des intellectuels manquant de véritables traditions communistes, qui pendant des années (de 1928 à 1933) n'ont pas eu la possibilité de militer sur le terrain des luttes ouvrières, a conféré à l'Opposition communiste en France un caractère petit-bourgeois qui a rendu aléatoire tout développement ultérieur du mouvement de la IVe Internationale en France au moment où la situation objective (les luttes prolétariennes de 1934 à 1939) fournissait une base solide à la propagation des idées de la IVe Internationale. Nous nous sommes engagés depuis le début de la guerre, dans la création d'une organisation de type révolutionnaire bolchevik. Le bolchevisme implique, avec une politique juste (qui pour nous est celle définie dans La IVe et la guerre et le Programme de transition qui continuent la ligne des 4 premiers Congrès de l'I.C.), un contact réel et étendu avec la classe ouvrière, la participation quotidienne à ses luttes ; il s'inspire des intérêts quotidiens et permanents de la classe ouvrière. Pour se dire parti bolchevik il faut avoir un certain poids organisationnel qui permette la conduite de la lutte de classes dans tout le pays, il faut des traditions de luttes ouvrières. Il faut avoir un bilan de lutte POLITIQUE favorable. Dans ce sens la question du parti ne peut et ne pouvait être résolue par nos propres forces de A à Z et en 1943 la question du parti reste ouverte. Mais notre travail a été conçu comme un travail en direction d'un parti bolchevik. Pour cela notre indépendance nous était et nous est vitale. Car on ne peut pas commencer la formation de militants communistes (qui le deviennent réellement par la pratique de la lutte de classes) dans un milieu petit-bourgeois opportuniste. Nous voulions et nous voulons au moyen de militants instruits et d'une politique conséquente, affirmer devant les autres organisations prolétariennes une conception révolutionnaire. Notre réussite dans cette tâche, si nous discernons dans la classe ouvrière les forces capables de former avec nous le parti, peut déclencher ou précipiter un regroupement sur la base communiste de tous les militants vraiment révolutionnaires de la classe ouvrière française. Dans ce sens la sélection que nous opérons actuellement en tant qu'organisation opposée aux autres, fera place demain à une nouvelle sélection des éléments réellement révolutionnaires à l'intérieur d'une seule et même organisation. Dans quel milieu trouvons-nous ce type de militant révolutionnaire ? Depuis le début de la guerre nous avons orienté nos efforts surtout en direction des militants du PC. Le PC avait des militants ouvriers communistes. Notre faiblesse numérique extrême ne nous a permis de tirer que peu de fruits de cette orientation d'un point de vue numérique. Mais proportionnellement à nos forces les résultats n'ont pas été négligeables. C'est cette orientation qui a permis notre existence en tant que groupe autonome. Mais les efforts de la bourgeoisie en emprisonnant ou en enfermant dans des camps des milliers de militants communistes de la base, et la déportation en Allemagne de 2 000 000 d'ouvriers dont une partie d'ouvriers communistes, rend le travail dans cette direction très difficile. Cependant pour l'avenir (récupération des prisonniers et des déportés, libération des emprisonnés), en ce qui concerne le recrutement, le travail dans cette direction reste le travail essentiel ; dans la situation actuelle il doit être dirigé notamment vers les très jeunes (16-18 ans) avec ou sans traditions politiques. Dans le camp des groupes se réclamant de la IVe la situation a quelque peu changé par une certaine activité d'usine. Cela est dû au fait qu'il existe en France un courant d'idées de la IVe Internationale dans certains milieux politiques et ouvriers. L'expérience de la guerre et les tournants staliniens ont contraint certains éléments ouvriers à se grouper dans le POI malgré l'incapacité de celui-ci de les organiser et de les conduire efficacement. Le POI a bénéficié de ce courant d'idées, malgré sa politique opportuniste, en tant qu'organisation numériquement la plus forte. Notre tâche
est de démontrer à ces éléments ouvriers
l'opportunisme
des dirigeants du POI et leur présenter une organisation et
surtout
des méthodes organisationnelles qui inspirent confiance. Pour
aboutir
à cette organisation et à ces méthodes
organisationnelles
justes il faut que, dans le travail révolutionnaire et
politique,
chaque membre de notre groupe perde ce qu'il a d'individuel et agisse
en
tant que membre d'une organisation. C'est seulement ainsi que nous
acquerrons
la cohésion interne nécessaire au travail de regroupement
révolutionnaire, travail pouvant prendre de multiples formes.
Ainsi, le contrôle démocratique et la structure centralisée du parti découlent de son contenu socialiste et révolutionnaire. La conception bolcheviste a été consacrée par la victoire de la révolution d'Octobre 1917. Mais la dégénérescence de la révolution d'Octobre, a remis en question la conception même du parti. Impuissants à s'expliquer le stalinisme comme le produit de la marche réelle de la lutte de classes (qui a abouti à une situation dans laquelle le prolétariat ayant pris le pouvoir et remplacé la propriété privée par l'économie planifiée est écarté du pouvoir politique par une bureaucratie qui tout en se maintenant sur la base des rapports établis par la révolution, représente au point de vue politique, social, moral, etc. la négation même du bolchevisme), de nombreux "critiques" en viennent à accuser le bolchevisme lui-même comme non démocratique, etc. et donc comme responsable du stalinisme. Mais aucun de ces critiques n'a réussi à inventer quelque chose de nouveau qui puisse empêcher le parti, qui est un moyen, de se briser dans l'accomplissement de sa tâche, soit à cause de son contenu matériel et idéologique insuffisant (comme divers partis naissants de la IIIe Internationale), soit après l'épuisement de ce contenu dans l'accomplissement de la tâche révolutionnaire : tel fut le sort du parti bolchevik en Russie. Ces "critiques" ont d'ailleurs fini à l'écart de la lutte révolutionnaire et sont revenus à des conceptions bourgeoises. LES MEFAITS DU STALINISME NE PEUVENT PAS ETRE IMPUTES AU BOLCHEVISME, DONT IL N'EST PAS LA CONTINUATION, MAIS LA NEGATION. La démocratie n'est pas une panacée, c'est une forme dont le contenu peut varier. L'expérience de la démocratie bourgeoise nous montre d'abord qu'elle cache une dictature : celle du capital sur les exploités. Le modèle de la démocratie formelle reste cependant la social-démocratie dans laquelle la démocratie complète (liberté complète de discussion) cachait en réalité la dictature politique d'un nombre restreint de politiciens sur les ouvriers social-démocrates. Cela s'explique par le double contenu petit-bourgeois (la majorité) et prolétarien (la minorité) des partis social-démocratiques. La dictature de ces politiciens professionnels ne pouvait pas être menacée par la liberté de parole, etc, tant que le parti était divisé par des intérêts de classes différentes. Par contre, la démocratie réelle, vivante, s'établit spontanément entre des gens visant au même but, porteurs d'une même flamme. Elle se manifeste dans toutes les révolutions populaires. C'est dans ce sens que Lénine affirme pour le parti : "AVEC CES QUALITES (secret rigoureux, choix minutieux des membres, préparation de révolutionnaires professionnels), nous aurons QUELQUE CHOSE DE PLUS QUE LA "DEMOCRATIE" : UNE CONFIANCE FRATERNELLE ENTRE REVOLUTIONNAIRES". La question de la démocratie a donc deux aspects : d'une part, dans tout groupement renfermant des contradictions de classe, la démocratie permet la libre expression des opinions de la minorité. La majorité peut la supprimer au nom des intérêts de classe qu'elle représente. Ainsi, quand la critique de la minorité révolutionnaire devint gênante pour la bureaucratie SFIO, elle chassa du parti cette minorité. Le sens réactionnaire de cette mesure résulte non pas abstraitement de la suppression de la démocratie pour les révolutionnaires, mais du fait qu'elle servait à la défense des intérêts de la petite bourgeoisie réformiste. Le parti bolchevik qui fut un des partis les plus démocratiques qu’ai connu l'histoire, supprime lui aussi certains droits démocratiques (droit de fraction, etc.) en l'année de péril 1920. Cependant, dans ce cas, la suppression des droits "démocratiques" fut une mesure révolutionnaire : il fallait, dans les conditions spéciales d'alors, empêcher la pression des classes petites-bourgeoises de se manifester à l'intérieur du parti bolchevik. D'autre part, dans un groupement ne renfermant pas de contradictions de classe et ayant un contenu révolutionnaire, la démocratie n'est pas une simple liberté de critiquer, de s'exprimer, c'est quelque chose d'infiniment plus, c'est une "confiance fraternelle complète entre révolutionnaires" qui par les efforts conscients de chacun détermine la direction générale, c'est un même effort opiniâtre pour rendre efficace le travail du parti, obtenir le meilleur rendement de la part de chaque membre, mettre chacun à sa place (l'homme qu'il faut à la place qu'il faut), redresser les fautes politiques, etc. Dans l'illégalité, le contrôle démocratique qui tend dans cette dernière direction, est beaucoup plus difficile que dans la légalité, mais il peut être aussi efficace. Il s'agit avant tout de trouver les moyens les plus propres à assurer un échange sérieux de haut en bas et de bas en haut entre les membres de l'organisation. Le cloisonnement de l'illégalité trouble donc la démocratie de l'organisation, c'est-à-dire l'échange politique et organisationnel facile et rapide entre tous les rouages du parti. Avec des avantages pour l'organisation (sélection plus rigoureuse des membres), l'illégalité comporte de graves désavantages pour le progrès politique de l'organisation. Dans ces conditions, c'est la préparation sérieuse de chaque membre, la qualité réelle de la direction, qui peuvent remédier partiellement à cette situation. Si bien que dans un groupement révolutionnaire ayant un contenu de classe prolétarien, démocratie implique centralisme. La condition la plus importante de l'instauration de la véritable démocratie, c'est la conscience socialiste élevée des responsables. Chaque responsable doit être convaincu organiquement que sans la démocratie, c'est-à-dire sans la participation active de tous, non seulement au travail pratique mais également à l'élaboration de la politique de l'organisation, il ne peut pas y avoir de parti révolutionnaire, donc de victoire du prolétariat sur la bourgeoisie. Seule la mobilisation totale de toutes les possibilités politiques et pratiques que renferme chaque militant permet à une petite organisation de se développer, à une grande organisation de conquérir des sympathisants, à une organisation ayant des sympathisants d'influencer les masses, et à une organisation avec sympathisants appuyée sur les masses de battre la bourgeoisie. Le parti n'est pas la simple somme de ses membres. Il est une qualité nouvelle et ce n'est que par les liens de parti que chaque membre s'élève bien au-dessus de ses forces individuelles, devient un militant. Le militant est le produit à la fois de sa propre activité individuelle et de celle encore plus importante, collective du parti. La subordination de toutes ses ressources morales, intellectuelles et matérielles à cette vie collective du parti est donc le devoir suprême du militant, en premier lieu vis-à-vis de lui-même. Le parti d'autre part, contrairement à la manière stalinienne, ne considère pas ses membres comme des unités sans importance, mais au contraire se retrouve dans chaque membre dans ce qu'il a de plus élevé et de plus précieux. Sur le plan moral, la première exigence du bolchevisme est la rupture complète de tous les liens avec la morale bourgeoise. On ne peut pas retenir les objections de ceux qui accusent le bolchevisme d'avoir produit l'amoralisme stalinien. La morale bourgeoise dans ses exigences les plus cachées est un des freins les plus puissants de la révolution prolétarienne. La morale du militant qui a rompu complètement, radicalement, avec la morale bourgeoise, est révolutionnaire là où le parti est appuyé sur le prolétariat, lié au mouvement des masses, là où le contrôle organisationnel et politique du parti sur les membres a comme condition le contrôle du prolétariat sur le parti par la confiance que celui-ci lui accorde. Et cette morale révolutionnaire confère au militant un comportement, une honnêteté sans pareils dans la société bourgeoise. Cette morale n'est pas une base abstraite (des règles sur ce qui est bien en général, sur ce qui est mal en général, ce qui est honnête, ce qui est malhonnête), elle a une base scientifique déduite, à l'aide de la méthode marxiste, de la lutte de classes. Les critères varient quand il s'agit d'ennemis directs, d'alliés temporaires ou du mouvement ouvrier. Le parti est d'autant plus sain que chacun de ses militants est plus instruit et pratiquement lié aux masses. Seule l'organisation centraliste bolchevik permet l'éducation dirigée des membres qui remédie le plus aux inégalités culturelles et théoriques en rehaussant au maximum les capacités culturelles et théoriques de chacun. Seule une organisation centraliste bolchevik permet le maximum d'efficacité dans le travail des membres vis-à-vis des masses (transfert des membres sur le terrain le plus adéquat à leurs capacités de travail pratique, mélange d'ouvriers et d'intellectuels pour obtenir le maximum dans le travail). En ce qui concerne le professionnalisme des militants, celui-ci n'implique pas l'abandon de tout lien avec la production ou les différentes sphères d'activité sociale. A part une petite minorité sélectionnée, sûre, qui sous le contrôle du parti accomplit des tâches permanentes (politiques ou techniques), le parti doit être lié à l'ensemble de la vie sociale. Le professionnalisme implique que chaque militant est à l'entière disposition du parti qui l'utilise comme il l'entend au mieux des intérêts de la classe, dans ou hors la production. Nous luttons pour la victoire de formes sociales plus élevées, socialistes, et le parti doit disposer du concours le plus large possible d'intellectuels, d'ingénieurs, d'administrateurs, etc. Dans ce sens il est lié et tâche de se lier en s'y créant des sympathisants, avec tous ces milieux. Mais le professionnel est membre du parti avant d'être ingénieur, etc. En résumé, nous voulons dégager un type de révolutionnaire opposé au monde bourgeois et pour y réussir, une discipline parfaite dans l'organisation est absolument nécessaire. Il faut tendre de plus en plus à organiser le travail d'une façon responsable et établir des liens de travail politiques et organisationnels entre les militants. Tout notre effort dès le début a été dans cette direction, le plus grand danger pour une organisation étant l'habitude de travailler en suivant les liens personnels ("amitié", façon de vivre, etc.) qui donne naissance à des petits groupes ou cliques et non pas à un ensemble de rapports résultant du travail organisationnel pratique et théorique. Pour procéder à la mise en place de tous les rouages, il est nécessaire de savoir quels sont les membres qui se sentent capables d'être "militants professionnels", soumis à la discipline absolue de l'organisation et déterminant par leur vote le cours de notre travail. Ceux qui ne s'en sentent pas encore capables, c'est-à-dire qui ne trouvent pas encore une base suffisante dans le passé et le présent de l'organisation, continueront à militer comme jusqu'à présent, mais ne pourront pas déterminer les voies politiques de notre organisation. Nous ne connaissons maintenant que les côtés difficiles et pénibles de cette vie, mais notre développement et la lutte des masses transformeront cette situation de professionnel en privilège en faisant apparaître tout ce qu'une telle vie contient de fort et de profondément humain. Ce qui caractérise
le révolutionnaire, c'est qu'il n'attend de son activité
qu'une seule récompense, c'est la reconnaissance tôt ou
tard
que celle-ci a été conforme aux intérêts
véritables
de l'humanité. C'est pourquoi il peut résister à
toutes
les épreuves : s'il est relativement facile de donner sa vie
d'un
seul coup, il faut savoir aussi la donner peu à peu dans la
lutte
opiniâtre que nécessite le renversement de la bourgeoisie.
Ce type d'individu n'est pas rare. Le parti dégage ce sentiment
de sacrifice total, de dignité et, si l'on veut de
félicité.
|
|
"...Sans une "dizaine" de chefs de talent (les talents ne surgissent pas par centaines) éprouvés et professionnellement préparés et instruits par une longue pratique, bien d'accord entre eux, aucune classe de la société contemporaine ne peut mener la lutte". "Le seul principe sérieux d'organisation pour les militants de notre mouvement doit être : secret rigoureux, choix minutieux des membres, préparation de révolutionnaires professionnels. Avec ces qualités, nous aurons quelque chose de plus que la "démocratie" : une confiance fraternelle complète entre révolutionnaires". "On a vu se vérifier une fois de plus la bonne remarque de Parvus, qu'il est difficile de saisir un opportuniste avec une simple formule : il signera aisément n'importe quelle formule et s'en dégagera non moins aisément, car l'opportunisme consiste précisément dans l'absence de tout principe déterminé et ferme". |